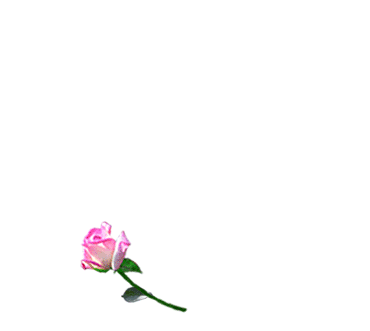-
Par renal le 8 Juillet 2014 à 08:16
La fille de l’Auberge
" Il était une fois une fille d'auberge. A l'aube elle lavait le plancher, au soir elle faisait la vaisselle, tout au long du jour elle trottait, servait l'un, accourait à l'autre, souriait comme il le fallait, bien qu'elle fût à tous transparente. Personne ne semblait la voir. On criait à boire, à manger, on claquait des doigts, elle venait. Elle n'avait même pas de nom. Qui était-elle ? La servante. Elle traversa ainsi la vie sans que nul ne se soucie d'elle. Elle mourut. On la mit en terre. Elle s'éveilla au paradis.
Elle ne put en croire ses yeux, d'autant qu'elle ne se trouvait pas au paradis de tout le monde. Elle était au jardin des Saints. " Que suis-je venue faire ici ? Se dit-elle. Je ne suis rien. Je ne peux pas être une Sainte ".
Les Bienheureux vinrent à elles, l’embrassèrent, lui firent fête. Elle leur demanda :
- Pourquoi moi ?
Ils répondirent :
- Dieu le sait.
L'un d'eux lui dit qu'à son avis elle avait aimé ses semblables au point d'en oublier sa vie.
- Aimé ? Oh non ! (Elle osa rire. Jamais encore elle n'avait ri). Je manquais de temps pour cela. J'étais une fille d'auberge. J'avais beaucoup trop de travail.
- Quel est ton nom, ma bonne amie ?
- Je n'en ai pas, répondit-elle. Je n'en ai jamais eu, je crois.
Perplexité des Bienheureux. Ils s'assemblèrent tous à l'ombre du plus vieil olivier du Ciel, en conciliabule pensif.
- C'est anormal. C'est impossible. Comment les gens la prieront-ils ? Il faut qu'elle soit Sainte-Quelqu'un !
Une brise émut le feuillage. Chacun se tut, leva le front.
Vint un murmure. C'était Dieu.
- Elle sera la Sainte sans nom. A elle iront toutes les peines, toutes les prières secrètes qu'on ne sait à qui adresser.
Depuis ce jour, à ce qu'on dit, c'est elle, la fille de rien, l'inconnue de tous en ce monde qui accueille les espérances, les désirs profonds, les soucis que l'on ne peut même pas dire. Ce sont, de tous, les plus nombreux. La sainte servante sans nom n'a pas un instant de repos, mais qu'importe, elle est faite ainsi, toujours à servir, même au Ciel. "
(Henri Gougaud, Le livre des chemins)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 3 Avril 2014 à 08:41
Le Kyudo ou la voie de l'arc
" Lors d'une session de tir à l'arc dirigée par maître Satoshi Sagino, un élève lui demande :
- Que faut-il faire, et que je ne fais pas, pour que la flèche atteigne la cible ?
Le maître éclate de rire et dit :
- Pourquoi posez-vous la question à l'envers ?
L'élève ne comprend pas et le maître dit :
- C'est une fausse question. La vraie question est : qu'est-ce qui empêche la flèche de percer le centre de la cible ?
Et dans un nouvel éclat de rire, il ajoute :
- Parce que percer le centre de la cible est la vocation de chaque flèche !
L'élève repose alors la question à l'endroit :
- Qu'est-ce qui empêche que la flèche atteigne le centre de la cible ?
Et maître Sagino répond :
- Deux choses : le désir de réussir à tout prix, ou au contraire la crainte d'échouer. Les empêchements viennent des préoccupations du moi. Comment s'en libérer ? En se consacrant pleinement au tir, sans pensées, sans but, sans désir, sans fierté, sans peur. Alors le tir se fait dans la liberté de l'être. Mon maître, Umeji Roshi, disait : " Si vous faites une chose à fond, vous allez vous transformer de telle façon que tout ce que vous regardez, vous le verrez autrement. "
Henri Gougaud
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 11 Décembre 2013 à 10:37
La vie
Elle prend bien sa source quelque part, la vie. Mais où ? D'où vient cette force qui donne au feu son impertinence, à la terre son appétit d'ogresse, à tout être vivant son désir de jouir du monde ? Demandez à la tempête ce qu'elle pense des convenances, demandez-lui ce qu'elle pense de la mort, demandez au feu, à l'air, à la terre. Ils n'ont aucune mémoire de ce qu'est la mort, ce mot n'existe pas dans la nature. Un caillou peut vous parler de l'innocence, mais il ne peut pas vous parler de la mort, pas plus que du bien, du mal, de l'utile, de l'inutile. Il ne sait rien de tout cela. Demandez à la vie à quoi elle sert. Elle ne vous répondra pas. Elle ignore tout de nos philosophies, elle ne sait pas ce que signifie le mot " néant ", voilà tout. Ce mot pour elle n'est qu'un bruit. Comment pourrait-elle comprendre ? La vie vit pour vivre. Elle n'est qu'une force qui va, gratuite, sans questions et sans cesse donnée. Libre à vous de l'épouser, de la voir comme elle est, de l'aimer simplement pour le bonheur d'aimer. Et si vous ne voulez pas d'elle, que lui importe, elle passera sans vous.
(Henri Gougaud)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 24 Juin 2013 à 08:42
Le péché
Au temps des chrétiens sans pouvoir, Pohémen vécut au désert. Il était de ces pères saints qui ne désiraient rien au monde que ressentir peut-être un jour, un bref instant, juste le temps d’un battement d’ailes d’un ange, le souffle de l’amour divin. « Si tu veux que Dieu te caresse, dit un proverbe universel, mieux vaut être nu qu’habillé ». Pohémen n’avait donc, pour tout bien ici-bas, qu’une guenille monacale, une écuelle et un bâton
A quelques heures de sa hutte, sur un piton de roc brûlé étaient les murs d’un monastère où vivaient reclus des ascètes presque aussi démunis que lui. Or, il advint qu’un de ces frères commit un péché consternant. L’histoire ne dit pas lequel, mais il fut jugé gravissime. Les moines, à l’unanimité, estimèrent donc nécessaire de punir le contrevenant. Mais quel tourment lui infliger qui ne soit ni trop éprouvant ni trop simplement oubliable ? On resta longtemps silencieux, on risqua de vagues idées qui eurent tôt fait de se perdre comme ruisseaux dans les cailloux.
- Remettons cette affaire au père Pohémen, dit enfin le plus vieux des sages. Il est le meilleur d’entre nous. Il saura juger proprement.
Il fut aussitôt approuvé. On fit prévenir le bonhomme. Il demanda au messager ce que l’on attendait de lui. L’autre lui exposa la chose. Il l’écouta, hocha la tête et lui répondit qu’il viendrait
Le lendemain, après la messe, le frère veilleur sur sa tour aperçut au loin Pohémen sur le sentier du monastère. Il appela ses compagnons. Il leur désigna le bon père qui peinait à traîner un sac parmi les rocs ensoleillés. On accourut à sa rencontre. On s’étonna. On le plaignit de le voir s’échiner ainsi à charrier quoi donc au juste ?
- Un sac de sable, mes amis, leur répondit le saint ermite.
- Mais il est troué de partout !
- Mes frères, je le suis aussi! Derrière moi mes fautes tombent, elles se perdent sur mon chemin, elles ne sont pour moi rien de plus que poussière sous mes talons. Amenez-moi donc à ce moine qui se morfond dans son péché, je l’embrasserai de bon cœur. Ce qu’il a commis n’est que sable déjà mangé par le désert. Nous avons autre chose à faire que de compter les grains de peine qui dégringolent de nos sacs. Allons, de l’eau fraîche, j’ai soif !
(Henri Gougaud, Le livre des chemins)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 11 Juin 2013 à 08:10
Un conseil
C’était au temps où le désert était le refuge des saints, des ermites, des fous de Dieu, des affamés d’éternité. Il advint donc qu’un de ces jours de sable ardent sous les oiseaux un jeune novice s’en vint à la porte de la cabane où vivait l’abbé Pohémen. Il appela.
- Entre, mon fils. Que veux-tu de moi ? dit l’abbé.
Ils s’assirent dans l’ombre tiède où n’était rien qu’une litière, un bol et une cruche d’eau.
- Mon père, dit le moinillon, je dépéris, je suis en peine. Je me sens, malgré mes efforts, mal accordé de cœur et d’âme au maître qui guide ma vie. Je sais que vous le connaissez. Sa foi, sa force et sa sagesse sont indiscutables, et pourtant quelque chose grince entre nous. Conseillez-moi, je vous en prie.
« C’est étrange, pensa l’abbé. Ce jeune moine, en vérité, n’a pas besoin de mon conseil. Il sait ce qu’il convient de faire. Pourquoi donc est-il indécis ? » Il lui dit enfin :
- Mon garçon, veux-tu que cet homme t’enseigne ?
- Evidemment, oui, j’aimerais.
- Eh bien reste avec lui, c’est simple, répondit l’abbé Pohémen.
Le moine le remercia et retourna, la tête basse, à l’ermitage montagnard où son maître avait son logis.
Passèrent vingt ou trente jours. Un matin, dans le vent des dunes, Pohémen vit quelqu’un courir. C’était à nouveau le novice. Parvenu dans l’ombre du seuil :
- Mon père, dit-il, aidez-moi. Je m’efforce autant que je peux, mais les paroles de mon maître ne me font pas de bien du tout. Ma foi, auprès de lui, s’éteint. Que dois-je faire ? Eclairez-moi.
- Que désires-tu ?
- Qu’il m’instruise, et que j’en sois enfin heureux.
- Retourne donc auprès de lui, mon garçon. Que te dire d’autre ?
- Mais enfin, risqua le novice.
Il n’en dit pas plus et s’en fut. Il s’attarda dans le désert jusqu’à la nuit, perclus de doutes. Comme le feu de l’ermitage apparaissait parmi les rocs : « L’abbé Pohémen a raison, se dit-il. Dieu veut m’éprouver. Je dois donc me faire violence et quoi qu’il m’en coûte, tenir ». Il tint à peine une semaine.
Quand l’abbé le vit revenir, il rit tout doux, le nez au vent.
- Alors ? dit-il.
- Je n’en peux plus.
- Tu le quittes donc ?
- Je le quitte.
- A la bonne heure, dit l’abbé. Qu’avais-tu besoin d’un conseil ? Fallait-il donc que tu en viennes à maudire ta propre vie pour écouter enfin ton cœur ? Car c’est lui, le meilleur des maîtres ! Sois fidèle à ce que tu sens, et quoi qu’il t’arrive, jeune homme, tu n’iras jamais de travers. Entre donc, j’ai quelques galettes qu’un caravanier m’a données. Elles sont parfumées au cumin. N’en as-tu pas l’eau à la bouche ? Bénies soient-elles, et toi aussi !
(Henri Gougaud, Le livre des chemins)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 20 Mai 2013 à 09:46
L’Invisible
C’était au temps d’avant les villes. Dans la montagne, au grand là-bas, au bord du lac où vont les rennes était un village d’Indiens. Au bout de ce village était une cabane solitaire sur le rivage. Là vivait un homme puissant mais invisible aux yeux des gens. Son corps était d’air transparent. Il avait une sœur cadette qui s’occupait de sa maison, de ses repas, de ses habits. D’elle seule il était visible. C’était un chasseur invincible et si beau, à ce qu’elle disait, que toutes les filles du lieu désiraient être aimées de lui. Sans rival est l’amant rêvé. Il peuplait donc leurs jours, leurs nuits. Mais il ne pouvait épouser que celle, subtile entre toutes, qui le verrait comme il était
Et donc les choses allaient ainsi. Quand l’Invisible, au crépuscule, s’en revenait du haut du mont, sa sœur disait à ses compagnes :
- Mon frère arrive. Qui le voit ?
- Moi ! disait l’une.
Et l’autre :
- Moi !
- De quoi est fait son vêtement ?
- De cuir fauve !
- De tissu rouge !
Elles n’avaient rien vu. Elles mentaient.
- Frère, rentrons.
Ils s’éloignaient et les filles restaient pensives à regarder leur songe fuir.
Or, au village, étaient trois sœurs. La plus grande était une teigne. La deuxième avait le cœur sec. La cadette était maladive. Les deux autres la détestaient, elle était leur souffre-douleur. Elles lui charbonnaient la figure, elles riaient d’elle, elles la battaient. La pauvre ne protestait pas. Elle fuyait quand elle le pouvait ou se laissait faire, innocente, les mains sur ses cheveux défaits. Vint le jour où les deux aînées s’excitèrent assez l’une l’autre pour vouloir tenter, elles aussi, d’attirer l’œil de l’Invisible. Elles s’attifèrent joliment. Robe de daim, tresses fleuries, bracelets de cailloux polis, ceinture ornée de coquillages, elles prirent le chemin du lac. Le soleil s’enfonçait dans l’eau.
- Mon frère arrive. Qui le voit ?
- Moi ! dit l’aînée.
- Moi, moi ! dit l’autre.
- Comment tire-t-il son traineau ?
- Avec une lanière verte. Comme il la tient, comme il est beau !
- Non, avec un rameau d’osier !
- Frère, rentrons. Ces filles mentent.
Les deux sœurs cognèrent du pied et s’en retournèrent chez elles.
Leur cadette, le lendemain, figure noircie, jambes nues, s’en fut ramasser dans le bois quelques écorces de bouleau. Elle peignit, dessus, quelques daims, avec soin, en tirant la langue. Elle en décora ses haillons, puis elle chaussa des mocassins aussi vieux que son père mort, et quand rougit le fond du ciel elle descendit au bord de l’eau. Ses deux aînées la poursuivirent.
- Honte, honte, tu nous fais honte ! Tu pues la cendre et le charbon ! Retourne à ton terrier, renarde !
Elles lui jetèrent des cailloux. D’autres filles, sur son chemin se la désignèrent en riant.
- Voyez-moi cette mendigote ! Ecartez-vous, elle a des poux !
Seule la sœur de l’Invisible l’accueillit avec amitié. Assurément elle savait voir ce que ne voient pas les yeux sales.
- Mon frère arrive. Le vois-tu ?
- Oui, je le vois, dit la petite.
- La lanière de son traineau, dis-moi, de quoi est-elle faite ?
- Des sept couleurs de l’arc-en-ciel.
- Et la corde de l’arc qu’il porte ?
- C’est le chemin blanc des Esprits, la voie lactée, la lumineuse.
- Viens avec nous, lui dit la sœur.
Elle prit la fille par la main, elle la mena dans sa maison, elle lava son corps, sa figure, elle lissa ses longs cheveux noirs, puis dans un coffre de bois bleu elle prit une robe de noce, elle en vêtit son invitée aux yeux pareils à des étoiles. Enfin l’époux entra, rieur et magnifique. Il lui dit :
- Femme, te voici.
Elle le regarda sans répondre, et le conte se tait aussi.
(Henri Gougaud, Le livre des Chemins)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 1 Avril 2013 à 09:31
Un jour, chez Ryoben
L’empereur est vieux, fatigué. Les danses rouges, les musiques, les femmes, les ors, les désirs, tout cela se fond désormais dans des brouillards indifférents. Il n’a plus le cœur à la fête. Et d’ailleurs, l’a-t-il jamais eu ? Seul son esclave le plus proche connaît le mal qui trop souvent fait tomber son front dans sa main. Aucun fils ne lui est venu, et plus que jamais il en souffre. Heureusement, de temps en temps, il s’évade en catimini. Il revêt un manteau de laine et par une porte discrète au fond de son vaste jardin il sort dans la friche venteuse. Il respire enfin sans souci. Au loin, dans la vallée déserte, à l’ombre d’un vieux pin penché est un feu malingre qui fume, un balai appuyé au mur. La cabane de Ryoben. C’est là qu’il retrouve la paix à boire en silence le thé en compagnie du saint ermite, à parler de tout et de rien, à regarder le temps passer.
Ils sont ensemble, ce jour-là, assis devant la porte basse. Brise légère. L’empereur chauffe ses mains au bol fumant que Ryoben vient de remplir. Il lui dit enfin :
- Mon ami, tu es l’homme le plus exquis, le plus sage et le plus savant qu’il me fut donné de connaître. Tu sais que je n’ai pas de fils. Le temps m’a blanchi les cheveux, le manteau impérial me pèse. J’aimerais que tu me succèdes. Je t’offre mon trône. Prends-le, et je pourrai mourir en paix.
Ryoben relève la tête. Pas une ride de son front, pas un poil de sourcil ne bougent, mais il rougit légèrement et son regard s’embrume un peu. L’empereur insiste.
- Imagine. Tous les pouvoirs, tous les plaisirs, droit de vie et de mort partout, jusqu’au fin fond de ton empire, sofas, concubines, thés rares, bibliothèques, temples, prisons, tout ce que j’ai, je te le donne. Es-tu content, dis, mon ami ?
En vérité, il n’a pas l’air. Il semble même, en ses dedans, avoir du mal à maîtriser un dragon levé du pied gauche.
- Pardonne-moi, dit-il, glacial. Il me faut aller me laver.
Il tourne les talons, descend vers le ruisseau, s’accroupit dans l’herbe du bord, plonge sa tête dans l’eau vive. Un paysan du voisinage s’en vient par le sentier pentu. Sa chèvre trotte à son côté.
- Ho, Ryoben, que fais-tu là ?
- Ne vois-tu pas ? répond l’ermite. Je me décrasse les oreilles. L’empereur m’a craché dedans des paroles extrêmement sales. Il m’a proposé ses pouvoirs, son palais, son manteau, son trône. Bref il veut me voir comme il est !
L’autre soupire.
- Je comprends. Mais voilà le ruisseau souillé par ces impériales sottises. Allons, ma chèvre, nous rentrons. Tu ne pourras pas boire ici avant au moins demain matin.
(Henri Gougaud, Le livre des chemins)
http://www.henrigougaud.fr
Photo Renal votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 22 Janvier 2013 à 09:34
Le rayon de lune
Mackam était un jeune homme au cœur bon, à l'esprit rêveur, à la beauté simple. Il souffrait pourtant d'une blessure secrète : il voulait savoir. Savoir quoi ? Il n'aurait su le dire. Son désir était comme une soif sans nom, une soif qui n'était pas de bouche, mais de cœur. Il aimait la lune d'amitié forte et fidèle. Elle lui avait appris à dépouiller la vie de ses détails inutiles. Quand elle apparaissait, ne restait alentour que la pointe de la mosquée, l'ombre noire de la hutte, la courbe du chemin, rien d'autre que l'essentiel, et cela plaisait à Mackam.
Or, une nuit, comme il revenait, le long du fleuve, de l'école coranique, l'envie le prit de dormir dans cette tranquillité où son âme baignait. A la lisière du village il se coucha donc sous un baobab et écouta les bruits menus alentour. Le ciel était magnifique. Les étoiles brillaient comme d'innombrables espérances dans les ténèbres. Mackam en fut empli d'une telle douceur que sa gorge se noua. « Savoir la vérité du monde, se dit-il, savoir enfin ! » Il regarda la lune. Alors il sentit un rayon pâle et droit entrer en lui par la secrète blessure de son esprit. Aussitôt, le long de ce rayon fragile, il se mit à monter vers la lumière. Cela lui parut facile. La pesanteur du monde lui parut bientôt comme un vieux vêtement délaissé. Il se dit qu'il allait enfin atteindre cette science qui l'apaiserait pour toujours. Il s'éleva encore, parvint au seuil d'un vide immense et lumineux.
Alors il entendit un cri d'enfant lointain. Quelque chose en lui remua, un chagrin oublié peut-être. Le cri se fit gémissant dans la nuit. Il s'inquiéta. « Pourquoi ne donne-t-on pas d'amour à cet enfant ? », se dit-il. Il se tourna sur le côté. Il était à nouveau dans son corps, sous l'arbre. Et dans son corps il vit la cour d'une case, et dans cette cour un nourrisson qui sanglotait, les bras tendus à une mère absente. Il se dressa, le cœur battant. Il n'y avait pas d'habitation à cet endroit du village. Il murmura : Qui est cet enfant ?
- C'est toi-même, répondit une voix au-dessus de sa tête.
Il leva le front, vit un oiseau noir sur une branche du baobab. Il lui demanda :
- Si c'est moi, pourquoi ai-je crié ?
- Parce que ton esprit seul ne pouvait suffire à atteindre la vraie connaissance, lui dit l'oiseau. Il y fallait aussi ton cœur, tes souffrances, tes joies. L'enfant qui vit en toi t'a sauvé, Mackam. S'il ne t'avait pas rappelé, tu serais entré dans l'éternité sans espérance, la pire mort : celle où rien ne germe. Brûle-toi à tous les feux, autant ceux du soleil que ceux de la douleur et de l'amour. C'est ainsi que l'on entre dans le vrai savoir.
L'oiseau s'envola. Mackam s'en fut par les ruelles de son village. Près du puits, l'âne gris dormait. Sous l'arbre de la place, une chèvre livrait son flanc à ses petits. Au loin, un chien hurlait à la lune. Pour la première fois, elle parut à Mackam comme une sœur exilée, et il se sentit pris de pitié pour elle qui ne connaîtrait jamais le goût du lait et la chaleur d'un lit auprès d'un être aimé.
Henri Gougaud (extrait de Jusqu’à Tombouctou », de Michel Jaffrennou
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 18 Janvier 2013 à 10:42
La couleur de la neige
Srulek parle yiddish, c’est le fou du ghetto. Le voici un matin d’hiver sur l’unique banc de la place. A côté de lui, un aveugle. Tous les deux grelottent. Il fait froid.
- Comment est la neige, dis-moi ? demande l’homme sans regard.
- Elle est blanche, répond Srulek.
L’autre médite, hoche la tête.
- D’accord, mais blanche, c’est comment ?
- C’est comme qui dirait du lait.
- Et le lait, dis-moi, c’est comment ?
- Les cygnes qui vont sur le lac, dit Srulek, tu sais, ces oiseaux avec un long cou recourbé, eh bien ils sont comme le lait.
Il allonge le bras, il courbe le poignet pour imiter le cou du cygne, et ce bras, l’aveugle le palpe, et le poignet, la main aussi.
- Ah oui, je vois, dit-il, je vois bien maintenant la couleur de la neige.
(Henri Gougaud, Le livre des chemins)
photo Renal votre commentaire
votre commentaire
-
Par renal le 17 Janvier 2013 à 09:13
Le vent
IL m'avait dit « Allez voir cet homme. C'est un maître, il sait beaucoup. Ce que vous avez besoin d'apprendre aujourd'hui, il vous l'apprendra ». C'était à Bamako. Il faisait ce jour-là un vent d'apocalypse.
Les tuiles et les oiseaux volaient ensemble au ras des toits, des chiens recroquevillés dans des encoignures de portes cochères regardaient en grelottant rouler des bassines ivres et défiler des cageots ailés dans les ruelles.
Je me souviens avoir péniblement longé des échoppes au rideau baissé, seul dehors, avoir tiré une porte que la tempête me disputait, m'être enfin enfourné dans une pénombre au silence étourdissant où je ne distinguai d'abord, aux murs et sur le sol, empilés dans des coins, suspendus au plafond, que d'innombrables tapis vaguement éclairés par des lumignons invisibles.
Au fond de la salle, cinq ou six hommes buvaient du thé autour d'une table basse. Je vis parmi eux se lever un vieillard aux gestes vifs. Un vieillard ? Son regard était d'une étrange jeunesse. Il m'accueillit avec bonté.
J'étais venu au rendez-vous avec quelques questions que je croyais essentielles. Je n'avais que peu de temps. Je reprenais l'avion pour Paris le soir même. Le vieil homme ne me laissa guère le loisir de parler, sauf pour répondre aux questions qu'il me posait sur ma vie, mon travail, ou la santé de l'ami qui m'avait envoyé à lui. Ces préambules me parurent interminables. Comme je me risquais, au détour de la conversation, à le pousser vers ce qui m'importait, il posa la main sur mon épaule et me dit : « Voulez-vous que je vous raccompagne ? » Ma mine déconfite l'amusa. Il m'entraîna dehors.
Dès la porte, il me sembla que la tempête avait redoublé. Il me prit le bras, et m'attirant dans le rugissement des rafales et les fracas de lointains échafaudages, il se mit enfin à me parler de ces choses qui m'avaient amené à lui. Je n'en perçus que des bribes. Le vent dévorait presque tout.
Ses mots à peine dits fuyaient de ci de là avec les détritus. Je lui proposai d'entrer dans un café. « Non, non, dit-il, marchons, ça fait du bien ! Il fait un temps magnifique ! » Je cheminai ainsi à son côté une heure, écartant les cartons qui nous venaient dessus, évitant les poubelles renversées, hurlant fiévreusement des questions infinies, m'agrippant aux réponses à peine dites, déjà perdues, désespéré que le vent me les vole.
Il me laissa à la portière d'un taxi. Avant de le saluer je mis un doigt à mon oreille et parvins à articuler que j'espérais avoir perçu l'essentiel de ce qu'il m'avait dit, malgré le vent. Il me répondit, comme s'il avait mal compris : « Ah oui, la vie ! La vie ! »
Quelques heures plus tard, dans l'avion qui me ramenait à Paris, j'ouvris un livre du poète Roger Munier. Je tombai sur cette phrase : « Ne m'écoutez pas plus mais autant que vous écoutez la pluie, le vent ». Me revint aussitôt, lumineux, le souvenir de l'homme de Bamako. Dans les tonitruantes bourrasques de la vie, il m'avait offert des éclats de paroles, comme des grains d'or dans un torrent. J'étais venu chercher auprès de lui quelques sous de savoir et il avait fait de moi, en une heure de temps, un orpailleur au bord du vent, qui souffle où il veut.
Henri Gougaud (extrait de Jusqu’à Tombouctou », de Michel Jaffrennou
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique